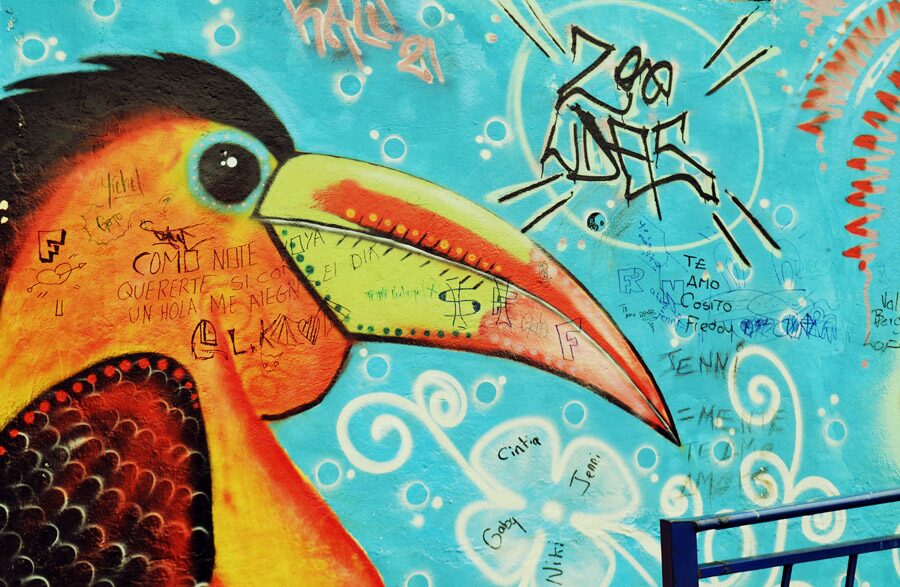Quelques jours avant Noël, entre le Nil et la Seine, dans un restaurant italien chic, sur une banquette en angle, contre un mur de vieilles pierres. L’ÉDITEUR dans un pull en cachemire bleu assorti à ses yeux. L’AUTRICE enveloppée d’un pashmina iridescent offert par L’ÉDITEUR.
L’ÉDITEUR : Il y a plein de gens qui croient qu’écrire, ça vient tout seul. Ils lisent trois livres et ils se disent qu’ils vont faire pareil. Alors que toi, tu pratiques depuis des années, tu as plusieurs romans dans tes tiroirs. Ça n’a rien à voir.
L’AUTRICE : Mon problème, c’est que je n’ai toujours pas identifié ce que j’ai envie écrire. J’ai toujours pensé que je voulais écrire de la fiction. Mais d’un coup, la vie est si… riche, si incongrue, si étrange, qu’elle dépasse toute fiction, et je me demande : est-ce que mon projet, aujourd’hui, ça ne serait pas de raconter cette réalité ?
L’ÉDITEUR : Ce serait presque naturel, tu t’y entraînes depuis des années.
L’AUTRICE : Mais je ne vais pas écrire sur ma life. Quelle légitimité ? Tout le monde s’en fout de la vie des autres, de la mienne. Et j’entends ta voix d’éditeur dans la tête : Qui va lire un livre sur ça ? Qui achèterait un livre sur la petite vie insignifiante d’Electre ?
L’ÉDITEUR : Mais les gens sont curieux de la vie des autres. De nombreux auteurs ont écrit sur leur vie, et ça a marché. Toi-même tu aimes lire la vie des autres. Tu aimes la vie des autres. Et ta vie… elle est drôlement intéressante, tu sais.
Jo, there is more to you than this. If you have the courage to write it.
— Friedrich Bhaer, dans l’adaptation cinématographique
de Little Women de Louisa May Alcott,
dir. Gillian Armstrong, 1994
Son : Thomas Newman, Under the Umbrella (End Title) – Instrumental, in Little Women Soundtrack, 1994.