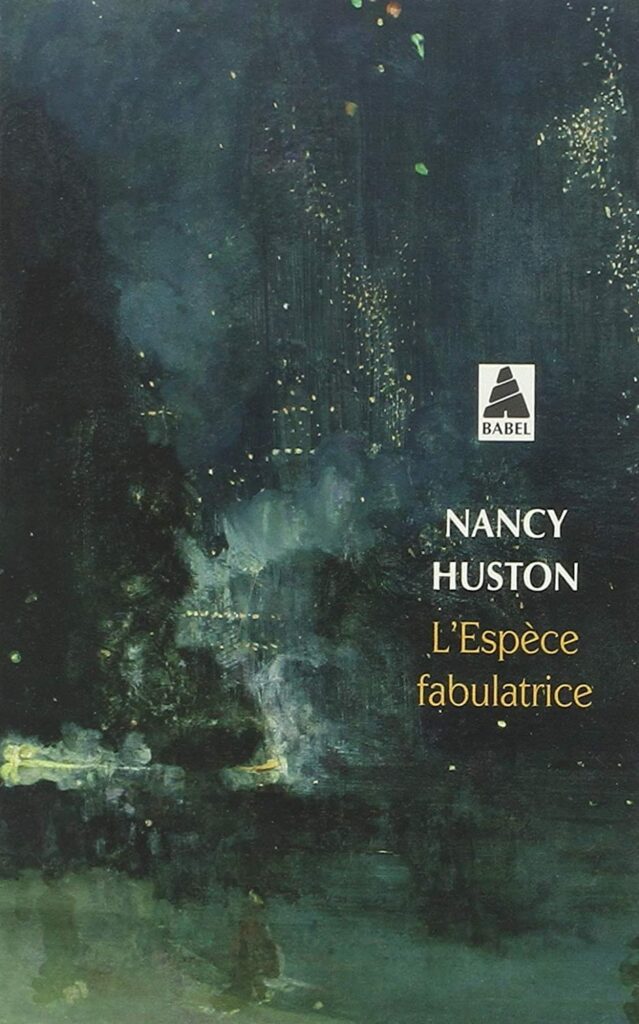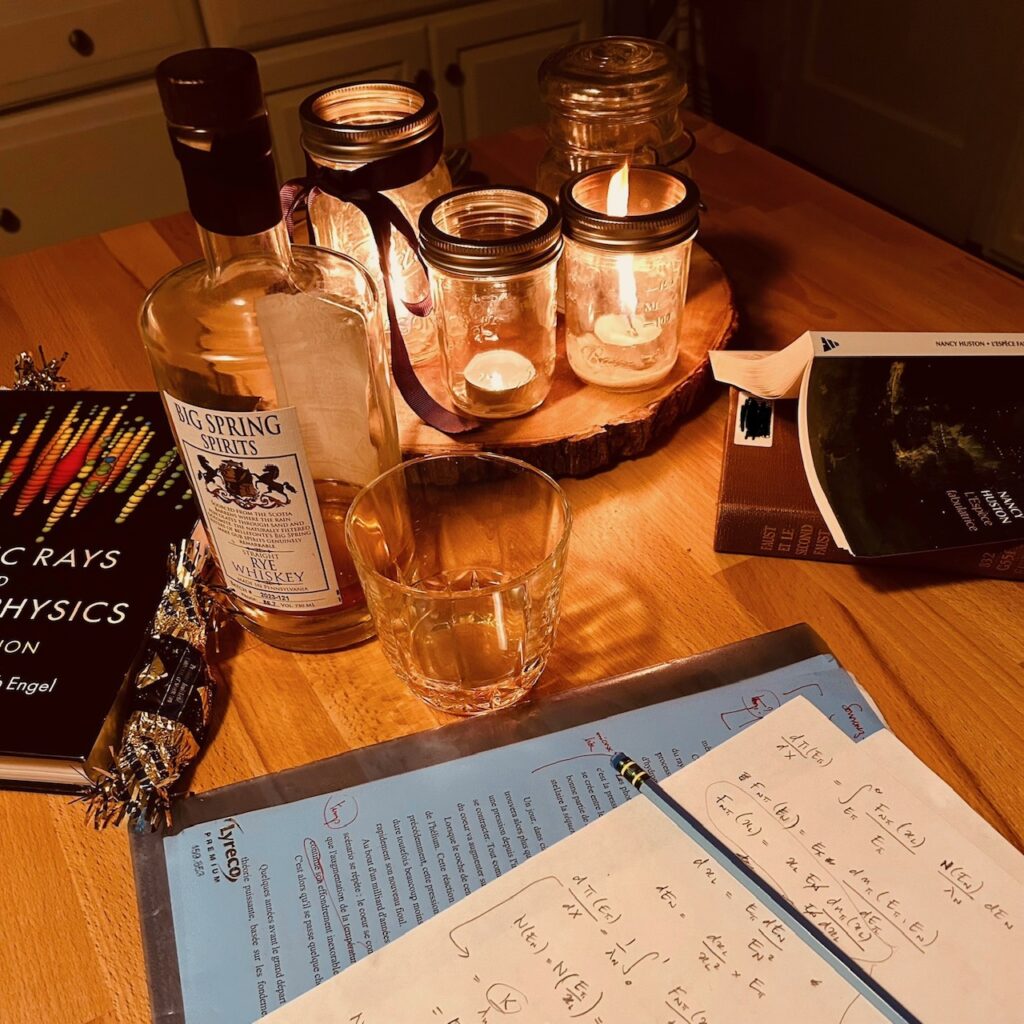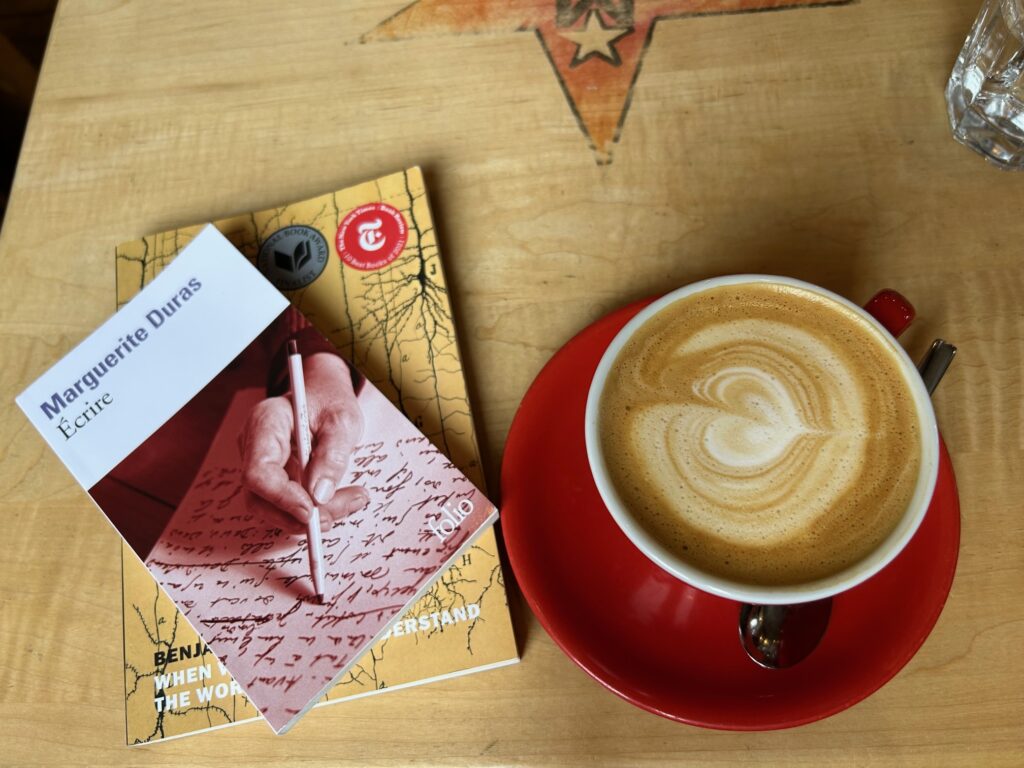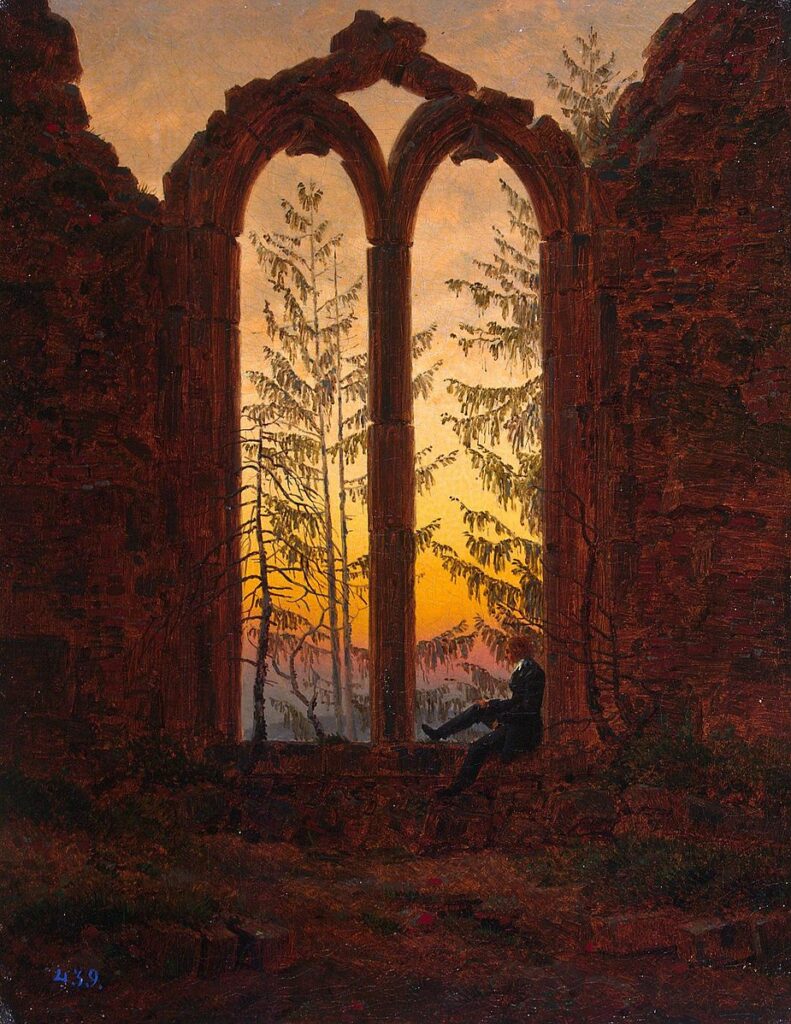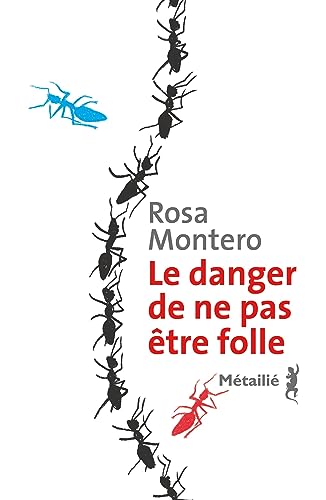Son : Thom Yorke, Jess Gillam, Jess Gillam Ensemble, Suspirium (arr. Rimmer), 2020
La Résidence de France sur Kalorama Road a quelque chose de factice à première vue, comme un décor de cinéma, avec sa statue de la liberté dressée dans le jardin, derrière les grilles noires, son éclairage bleu blanc rouge qui se prolonge dans le hall et dans les multiples salles surplombées de lustres de cristal comme des boules disco. Mais à l’intérieur, bois ancien et moulures remis au goût du jour, dans ce mélange architectural moderne épuré, de blanc, de miroirs et d’œuvres d’art monochromes. C’est élégant, sophistiqué, une vitrine parfaite de la France.

Lorsque J. me présente à son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, celui-ci commence par cette petite note galante : « Oui, je vous avais repérée ce matin à la NASA, vous avez posé une question qui m’a parue très pertinente. » Et moi, dans mon plus grand naturel, de lui annoncer dès les trois premières minutes de la conversation : « Le grand avantage de travailler comme astrophysicienne à l’Université de Kyoto, c’était que j’avais trois toilettes pour moi toute seule. » Je me dis : soit ça passe et ça détend l’atmosphère, soit je vais aller manger une autre part de galette à la frangipane. Au-delà de toutes mes espérances, il me répond en faisant une référence espiègle à Stupeurs et tremblements.
Alors nous nous isolons dans une petite bulle, au milieu du salon de la Résidence de France. Il me raconte son parcours, son fils, son précédent poste en Chine, il a le regard un peu triste et blasé, il est très élégant, et il se penche pour me dire toutes ces choses, par-dessus ses mains jointes, parfois je me demande : est-ce bien protocolaire ? Voilà vingt minutes que j’ai alpagué l’ambassadeur de France aux États-Unis et qu’il me regarde dans les yeux, comment dois-je le libérer ? Et c’est étrange, apaisant et très beau, ce qu’il me dit, sa vision si humble de la fonction, de l’être humain accessible sous la peau de la politique. Il me raconte quelques anecdotes et découvertes, je crois que je pourrais l’écouter me raconter le monde et les gens qui font ce monde, pendant des heures.
Finalement, nous rompons le charme, parce qu’il faut qu’il aille tenir de vraies discussions, s’entretenir avec de vraies personnes importantes, et moi que j’aille manger du jambon de Bayonne. C’est au lendemain, lorsque tout le bureau Science de l’Ambassade me tombe dessus pour savoir de quoi j’ai discuté si longuement avec Monsieur l’Ambassadeur, et pourquoi il avait l’air si absorbé, que je réalise que j’ai effectivement fait une magnifique erreur de protocole.
Le reste du temps, je joue les rôles que je suis venue jouer avec un plaisir certain, discuter science pure avec des chercheurs, stratégie avec des Prévôts d’universités, des dirigeants CNES ou NASA, le bureau CNRS à Washington, et à rattraper vingt ans avec mon attaché scientifique préféré. En soirée, je m’envole dans une présentation sur G. dans la salle de bal de l’ambassade, qui m’émeut autant que le public, je crois.
Puis je prends le volant : les notes de sax de Jess Gillam ouvrent les routes sombres et vallonnées du Maryland et de la Pennsylvanie. À une heure du matin, j’ai fait les trois quarts du chemin à peine. Je cligne des yeux, engourdie, mon esprit erre entre les murs blancs colorés de miroirs et de lustres bleu blanc rouge, je pense au goût de la truffe et du Comté, je pense à J. quand il me corrige : « si je peux me permettre, moi c’est la crise de la cinquantaine que je fais, » au visage de l’ambassadeur quand il s’incline pour me dire ce qui le touche, pour me dire sa surprise, éternelle, à soulever le voile, la peau humaine et découvrir l’altérité.
Je me gare chez moi, entière, à deux heures du matin. Et j’en suis un peu étonnée.