Denfert-Rochereau aux pavés vides et irréguliers, Paris grise et froide à la sortie du RER
Dans le hall d’entrée de mon laboratoire, le parfum assaillant de grands bouquets de lys – et autres restes d’une conférence terminée
L’odeur de vieux bois de mon bureau, ressortir mes tasses et mes stylos, les poser à leur place
Le déroulé lent et parfait du papier glacé de mon poster A0 au moment de l’impression
Arrivée à la maison, pousser la porte d’entrée, dés-enclencher l’alarme, recevoir dans les mêmes bras la chaleur et le parfum de chez nous
Un message qui parle de gants pour se protéger les mains, de sang, et de place dans mon « monde fascinant »
Les fils d’amies, de ma soeur, lunairement en phase
Lorsque la journée se déroule et parvient à son bout sans accroc, accompagnée de douceurs
Déposer ces mots.
M’écraser sans réfléchir dans le sommeil.
Étiquette : chercheur CNRS
La vie : étrangeté et sérendipité

Je m’émerveille encore de l’étrangeté de la vie. Malargüe, le vent et le sable, puis NYC avec la promenade déphasée dans Memory Lane, ensuite N. m’écrit : « I awfully need to talk to you, » alors nous conduisons chacune deux heures un lundi après-midi pour nous retrouver à mi-chemin au milieu de nulle part en Pennsylvanie, dans la ville-chocolat Hershey, déserte et décorée pour Noël, dans un café qui ressemble à la hutte du Père Noël – seul havre de lumière et de chaleur au cœur de l’irréel. Elle m’a à peine embrassée qu’elle me lance : « Depuis que je t’ai retrouvée, c’est le bazar dans ma tête ! Et ton truc de la crise de la quarantaine, en fait ce n’est pas cool du tout ! » Écho intéressant à cet autre ami cher qui m’écrivait il y a quelques jours : « Avec toi, je me mets à brasser toutes ces pensées et idées qui se trouvaient dans mon subconscient mais sur lesquelles je ne m’arrêtais pas avant… » Je réponds, un peu penaude : « Sorry. I don’t know what’s wrong with me. I seem to do this to people. »
Je pensais à nos conversations avec L. et à toutes les connexions survenues cette année sur cette veine-là. Est-ce que, d’une certaine façon, je catalyse quelque chose dans mes interactions ? Nous sommes tous à la même phase de notre vie, là où les nœuds se défont et se nouent, là où nous avons assez vécu, assez grandi pour revisiter le passé d’un regard neuf, envisager le futur d’un pas différent. Évidemment, ce n’est pas moi qui déclenche ces tourbillons – un peu d’humilité, tout de même ! Tout simplement, je suis de passage et les doigts ouverts pour saisir les morceaux d’âmes qu’on me tend, proposer les miens en retour. Et c’est merveilleux.
Au retour, je roule dans la nuit, j’ai 200,000 pensées à la minute, 200,000 mots à écrire, je songe à la réunion visio de ce matin à quatre, O., T., S. et moi, la pertinence de la discussion, la douce connexion humaine qui baignait le moment. La perspective de penser les étapes suivantes de G. avec ces trois-là – cette nouvelle vibration.
Je roule, et il se met à neiger, les flocons filent vers le pare-brise, éclairés par les phares.
C’est incroyable, vraiment, la sérendipité de la vie.
Au bureau, dans les toilettes d’un airbnb à Harlem, NY
Avec le décalage horaire, il était 5h30 du matin. Il s’agissait de suivre une réunion de comité de revue de mon laboratoire parisien. J’adore quand on me pose une question sur mon projet G. et que j’allume ma caméra pour répondre, avec en fond le rideau de douche fleuri. Cette incongruité, et son partage amusé avec l’Europe éveillée, assise au pied des toilettes pendant que ma famille sommeille, c’est encore une étrange forme de liberté, de luxe raflés à la vie.
L’île brisée
Je disais à P. ce soir, alors qu’on préparait une cranberry sauce pour la dinde, la purée de patates douces, la salade de pousses d’épinards aux noix de pécan… [When in Rome do as Romans do] : il faut vraiment que je termine ce livre et que je passe au suivant. Cette idée que nous sommes si seuls, chacun dans nos instituts, nos géographies, et que quand on se re-croise à ces conférences, à ces réunions de collaboration, le temps d’une nuit, d’un dîner, d’un café soudain on reconnecte, on se rassemble comme des pièces de puzzle, et que de cette façon si profondément humaine, on fait avancer la science… c’est cette notion-là que j’ai retrouvée cette fois-ci à Malargüe, et je me suis rappelée que c’est ça que je veux écrire.
Je repensais à cette belle phrase de Cocteau que m’avait offerte Jérôme Attal :
On travaille pour des frères mystérieux qu’on possède à travers le monde. Il y a une île qui est brisée, dispersée à travers le monde. Et, en somme, l’art est une espèce de signal, comme un mot d’ordre pour retrouver des compatriotes.
Peut-être que finalement, c’est la même chose en science comme en art.
Dephased
Moi : Je suis tellement déphasée que la première chose que j’ai faite en rentrant, est d’oublier d’aller chercher mes enfants et de me faire appeler par l’école…
Lui : Déphasé, c’est le bon mot. On est parti de cet endroit sec, plein de sable, immense, hors du temps, où tout se déroule lentement, et soudain en un clin d’œil (enfin, en 18 heures de transit) on se retrouve quelque part où il fait froid, vert, humide, dense. Sans compter le retour brutal à la vie familiale et les deux mille mails sur lesquels on a procrastiné. Mon cerveau n’arrive pas à processer cet écart. Je vais me coucher pour voir si demain, ça ira mieux.
Moi : Exactement. Perso, j’ai dormi quatorze heures, mais je peine encore à donner un sens à ce qui m’entoure.
Ce que je ne lui écris pas, c’est le bien fou que me fait cet échange. De lire mon ressenti par des mots d’autrui – en anglais, et dont je peux imaginer l’accent. Ce partage tissé sur deux semaines dont la silhouette subsiste par-delà les fuseaux horaires. D’avoir encore dans la tête tant de vent et de sable, ces lumières du couchant, ces nuages de Magellan, et de me sentir moins seule avec mes souvenirs.

Les connexions
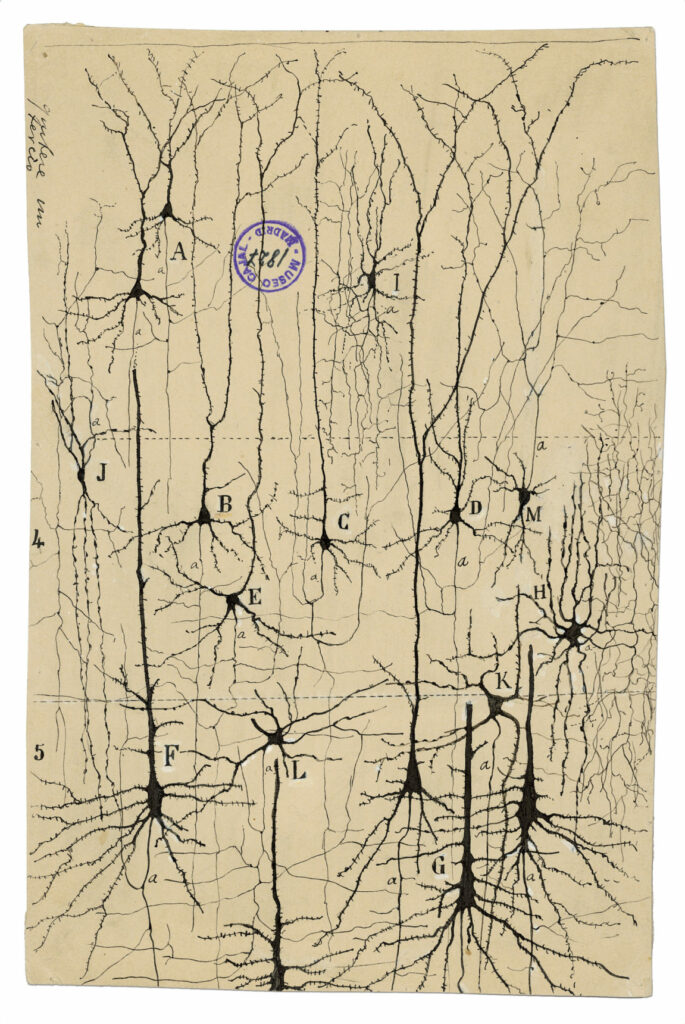
Lorsque j’arrive à l’aéroport de São Paulo, j’ai la gueule de bois d’avoir passé les deux dernières semaines ivre, pas que de Malbec, mais surtout de vent et de gens. J’ai du sable de la pampa partout. Dans les oreilles malgré les douches, dans tous les interstices de mon portefeuille, dans les coutures de mon sac, dans les chaussures, le téléphone. J’ai le coeur ridiculement ensablé des multiples découvertes humaines. Ces gens. Cette richesse, ces histoires vraies de la vie.
Les petits-déjeuners avec Ralph. M’échapper avec T. d’une session de présentations, aller faire voler son drone au soleil couchant ; ensemble contempler dans un silence serein les nuages-soucoupes et les longues ombres des touffes d’herbes dans la pampa depuis son oiseau mécanique à cent mètres d’altitude. Sentir ma main toute petite, serrée fort entre celles d’un collègue allemand, les yeux rougis par quelques compliments. Dans un bureau, pendant deux heures écouter une belle argentine déverser sa vie, sa fille, le père de sa fille, et toutes les joies et difficultés qui vont avec. « Pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? » s’arrête-t-elle d’un coup. Je me retiens de lui répondre : Oh c’est simple, comme dirait ma sœur, je dois dégager des phéromones cette semaine. La preuve ultime : pendant tout le dîner de collaboration Auger, un chat est resté accroché à mon siège.
À ce dîner, I. me confie, dans la pénombre, sous les arbres et à côté des moutons, dans l’odeur d’asado qui imprègne mon manteau : « Je crois que j’aime trop les gens. Ma mère me disait toujours d’arrêter de faire confiance. Mais on peut me blesser encore et encore, et toujours je finis par pardonner et trouver des excuses. » Je réponds que dans une certaine mesure, je suis comme ça aussi. Je sais les gens un peu noirs, un peu blancs, un peu gris. Et j’aimerais me concentrer toujours sur la partie blanche. Elle me sourit : « Exactement. Et tu sais, quoiqu’on en dise, je n’ai pas envie de perdre ça. » Je l’embrasse : mais oui, tu as raison. Il ne faut pas perdre ce regard, c’est notre qualité et non une faiblesse.
Je me rassois à côté de T. qui entre temps a fini son dessert. Plus tard, il m’attend pendant que je dis au revoir à tout le monde, dans d’étranges embrassades. Ralph me souffle : 7h demain pour le petit-déjeuner. T. et moi rentrons seuls sur une piste sableuse, dans la nuit noire. Il est une heure du matin. Orion comme un guide devant nous. Nous parlons de nos enfants et de choses sans importance, nous rions beaucoup. Il y a cette connexion douce qui nous soulève.
Je ne me lasse pas de voir les façades se morceler et révéler ce qui compte, au moment de ces ponts qui se tissent. La partie blanche et profonde des gens, qui me laisse surprise, éblouie, nourrie.
Ralph

Il y a ces personnes qui sont à 30 sigmas de toute forme de vie humaine. Ce théoricien allemand devenu aussi expérimentateur, à l’esprit d’une brillance hautement supérieure, si calme, bienveillant et visionnaire, est celui qui tient la collaboration Auger et qui dirige son institut depuis six ans. Sa présence dans une pièce est comme un baume. Les tensions s’apaisent et la physique ré-émerge. Il manie avec une force tranquille le langage scientifique comme les histoires drôles.
Tout le monde sait que c’est mon idole et j’en joue volontiers en plaisantant avec mes collègues, comme s’il était Brad Pitt – ou non, plutôt James Stewart. Avec son grand chapeau de cuir, son air doux mais ferme, sa silhouette bien faite et ses chemises bien repassées, il a effectivement une certaine dégaine – pas désagréable.
À Malargüe, l’homme le plus occupé de la communauté m’accorde deux dîners avec l’équipe allemande pour discuter stratégie autour du projet G. En rentrant du second, dans le lobby de l’hôtel, je tente ma chance et lui demande conseil sur ma carrière. Le lendemain matin, nous avions rendez-vous à 7h30 pour petit-déjeuner. Il a réservé une table dans un coin. Et il se passe ce que j’espérais secrètement : la connexion.
Nous parlons de tout ce qui importe. De sa fille. De mon fils. Il m’annonce aussi comme une évidence : Oui, tu vas prendre la direction de ton laboratoire – avec panoplie de raisons et conseils. Je n’en suis plus à ça près, et un jour où l’autre les frontières vont se dissoudre, alors je lui parle de mon livre. Comme Andromeda, comme N., comme K., il me dit n’avoir jamais rien lu qui donne la dimension de ce que nous vivons, nous scientifiques, et m’intime de l’écrire. Il est l’heure d’aller travailler. Il me propose : demain, on continue, à la même heure.
Le lendemain, je grignote mon alfajor trempé dans le mauvais café argentin et il dévore son breakfast continental. Il n’y a aucun déchet dans ce que nous partageons. Le soir-même, au dîner de collaboration Auger, devant deux cents personnes, il fait un one-man show, un discours drôle, fin, émouvant. J’y retrouve des bribes de notre conversation matinale. Je me dis que c’est une coïncidence, mais quand je l’attrape plus tard pour lui exprimer mon enthousiasme, il me fait un clin d’oeil, puis me propose : demain matin, avant ton départ, petit-déjeuner à 7h.
L’homme le plus sollicité de la communauté envoie gracieusement paître tout le monde pendant notre troisième petit-déjeuner en tête-à-tête : « Nous avons des choses à nous dire avec Electre. » Je sais qu’il est rentré se coucher la veille à 2h, a dormi à peine quatre heures pour discuter avec moi. J’avais aussi peu dormi, mais je m’en moquais bien.
Je me disais : peut-être qu’en conversant avec Ralph, en écoutant ses pensées, ses conseils, ses histoires, sa vision, sa sagesse va finir par infuser un tout petit peu en moi ? Je me plains tellement de manquer de reconnaissance dans mon métier, de donner tout le temps, du sentiment d’abus des hommes, je médis, je peste, je suis pleine de colère et d’aigreur. Et voilà un homme qui n’est que générosité et brillance d’esprit. Qui fait tout pour la communauté dans la considération de chacun et l’amusement de la physique, toujours débordé par ses engagements, les cheveux blanchis par ces six dernières années, et qui ne se plaint jamais.
Je monte dans mon taxi, affronter les quatre heures de route vers Mendoza puis mes quatre vols jusqu’en Pennsylvanie, et j’emporte avec moi cette réflexion : devant les ailes de la gaussienne, on ne peut que se sentir toute petite.
In the field
Dans les couloirs de l’Observatoire, cette question récurrente :
How was your field trip today?
Tous les jours, les quatre-quatre partent à l’assaut de la pampa, transportant des équipes de techniciens et de chercheurs, armés d’un talkie-radio, de boîtiers électroniques, de pièces mécaniques, de crème solaire, de chapeaux.
Visser, dévisser des câbles mâles et femelles
au voltmètre, contrôler des voltages
tester sur les panneaux solaires l’effet de l’ombre des grillages
attendre le clignotement vert de cartes mères rebelles.
D’antenne en antenne, déambuler et éviter les buissons d’épines.
On croise des chevaux sauvages, des vaches d’élevage, des serpents, des veuves noires, et de braves petites fleurs jaunes ou rose pâle, incongrues au milieu de l’aridité.
Pendant que M. termine sa série de tests, je m’abrite du vent, assise dans le sable, dos contre une antenne, je note les valeurs qu’il mesure sur mon téléphone. Les Andes, exceptionnellement enneigées cette année, semblent écrasées par tant de ciel.
La traversée des hémisphères et l’immensité crue a réussi à éteindre le flux de mots et de pensées dans ma tête. Je ne suis jamais aussi tranquille que in the field.

Truchas, nuages de Magellan, batteries et Malbec

Quand on me propose d’aller dîner à Las Truchas, évidemment je dis oui. Nous sortons de la ville au soleil couchant, roulons sur des pistes dans la pampa, et nous arrêtons à cette maison basse au bord de la rivière, bordée de bassins, labyrinthe d’eau en pierre, où circulent les truites. Le repas est une merveille, la compagnie agréable. Au retour, le ciel est parfaitement dégagé. Nous nous arrêtons : ça fait partie du rituel de Las Truchas, de regarder, bien repus, le ciel étoilé. Je me rappelle, il y a plus de dix ans, le coup de poing au ventre à la découverte des nuages de Magellan, sur cette même route. Il doit faire cinq degrés tout au plus. Dans le noir, j’ai froid et j’avale de tous mes yeux la bande galactique diffuse basse vers l’horizon, et plus haut les deux coups de bombe blanche. On aurait envie de tendre la main et de cueillir ces duvets intrus suspendus dans le ciel.

De retour à la civilisation, une série de messages de M. m’annonce que son car depuis Buenos Aires est enfin arrivé et qu’il a commencé à travailler dans l’atelier de l’Observatoire. Je l’y rejoins. Le gardien me reconnaît. Les lumières sont allumées à plusieurs fenêtres du bâtiment. Les physiciens et ingénieurs sont toujours au travail. Quand il me voit arriver, M. pose ses outils et m’étreint longtemps et tendrement. Jusqu’à minuit, nous installons l’expérience qu’il a conçue pour mesurer les capacités de nos batteries. Dans l’une des salles de mécanique, la radio allumée passe des airs de tango.
À une heure du matin, nous partageons des empanadas et un verre de Malbec dans le bar d’en face. Il n’y a pas assez de temps, il faut rentrer se coucher et demain sera encore une longue journée. Mais j’ai un flot de paroles inarrêtable, et avec M. c’est si facile de se confier, de tout raconter, mes conflits internes et mes colères, les dernières péripéties de la collaboration : il sait et comprend tout, son regard et ses suggestions ont une humanité posée. Au moment de se quitter, il me dit : demain, on boira chez moi, et on se promet que demain, on parlera de la vie.
Son : Ludovico Einaudi, Nuvole Bianche, in Una Mattina, 2004
Ventarrón
Le vent a quelque chose d’inhabituel ici. Vent lourd qui plie et ploie les interminables rangées de peupliers, qui soulève le sable et en transporte jusque dans votre lit. Hier soir, toute la ville éteinte parce qu’un saule s’est abattu sur une ligne électrique. Nous mesurons des voltages dans les boîtiers électroniques de nos antennes sur les grandes tablées de l’atelier de l’observatoire, je télécharge et analyse nos dernières données, nous buvons du mauvais café en attendant que ça se calme et que nous puissions retourner sur le terrain.
Son : Carlos Gardel, Ventarrón, 1933