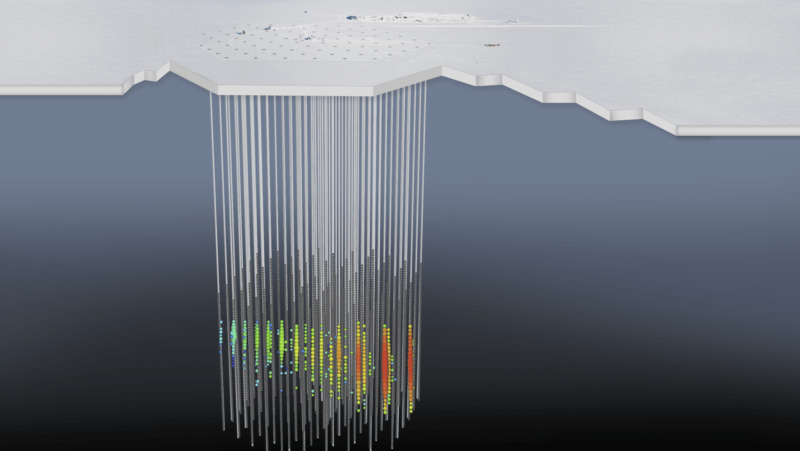« En somme, tu te fais chier, » conclut ma sœur, que j’appelle au milieu de sa nuit, les mains dans la vaisselle. Elle n’a probablement pas tort, ces derniers temps, à part ce chapitre qui luit comme une galaxie naine dans un vide cosmique, je n’ai rien à me mettre sous la dent, c’est la grande disette vibratoire. Pire : toutes mes interactions professionnelles sont de l’ordre de la crispation ou du naufrage, les problèmes pleuvent les uns après les autres, et j’ai absolument zéro aura, rien ne fonctionne, au mieux je ne sers à rien, au pire je rajoute de la friction.
P. est parti se requinquer à Paris, manger du saucisson et du fromage, installer l’arrosage automatique dans notre jardin – et travailler avec son doctorant.
C’est heureux : je peux pleinement utiliser mes garçons pour faire semblant de vivre un roman. Dans la journée, ils sont pleins de bonne volonté, et suivent les trames du quotidien que je leur ai tracés, pour ne pas me laisser déborder. Le soir, nous nous installons sur le lit de A. et c’est l’heure des partages.
Hier, c’était un chapitre de Surely You’re Joking Mr Feynman! en anglais dans le texte. Aujourd’hui, c’était des bouts du Rivage des Syrtes, des paragraphes à la volée pour camper le paysage, les lagunes, la froide amirauté de pierres dans la brume, la guerre figée avec le Farghestan, la rencontre avec Vanessa. Demain, ce sera Kean. Leur curiosité est piquée, ils ne veulent pas que je m’arrête. K. (six ans) affirme qu’il va lire tout seul la suite des mémoires de Feynman. A. veut savoir si la guerre va se remettre en branle dans la mer des Syrtes, et je me dis que s’il était meilleur lecteur (dans deux-trois ans ?), je lui fourrais Gracq entre les mains, et lui conseillerais de sauter toutes les descriptions pour aller se rendre compte lui-même*.
[C’est donc pour ça que j’ai fait des enfants – pour résonner ensemble la première fois que je pleure en lisant Electre, la première fois que j’écoute Sibelius dans la forêt enneigée, et pour cheminer avec eux à travers tous ces mondes, et retrouver de quoi m’abreuver, me nourrir.]
*J’ai bien conscience du sacrilège. Les descriptions dans le Rivage : évidemment l’essence onirique de ce texte, sans lesquelles il serait littérairement plat comme un pavé de Tolkien. Mais si mon fils s’intéresse à Gracq, je suis prête à accepter qu’il n’en lise qu’une page sur cinquante.