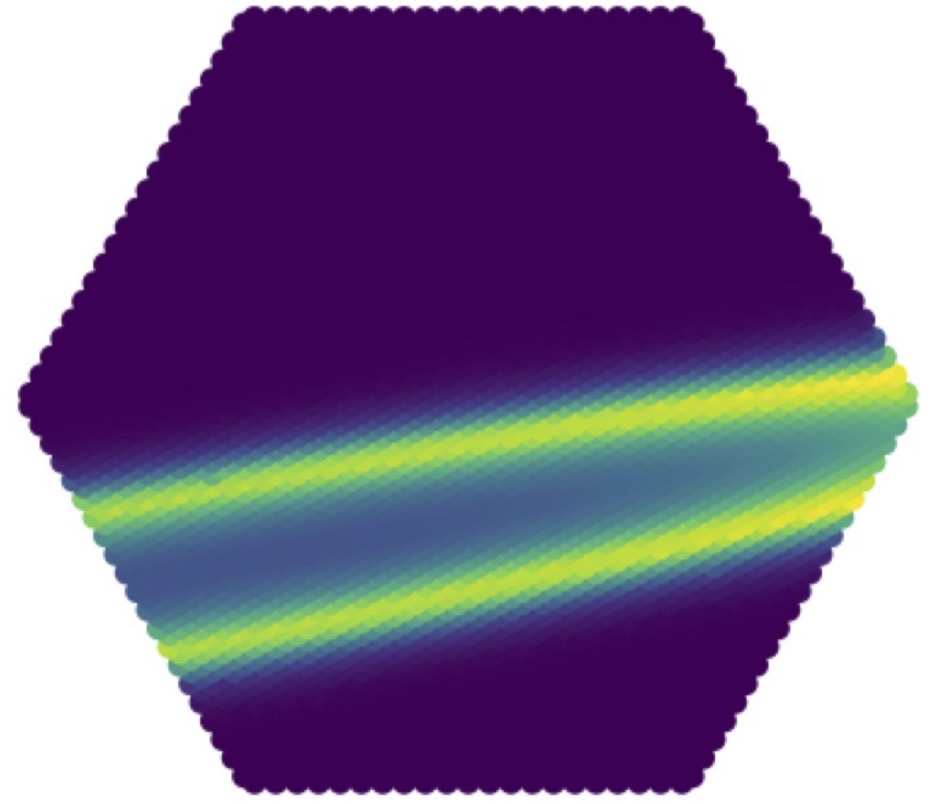Le soir, je migre vers le Nord sur le Mag Mile et fais semblant de me perdre, alors que je sais parfaitement où mes bottes me mènent. La nuit est glacée, effrayante et chatoyante de Noël, de trompettes rouges et or dressées sur State Street. Je débouche sur les dentelles gothiques qui couronnent les blocs du Chicago Tribune et du Wrigley Building. En bas la rivière encaissée entre les épis de maïs et une série de ponts rouges métalliques, prêts à se fendre et paralyser la ville pour laisser passer les bateaux.
Je marche d’un pas ferme, accompagnée de tous les fantômes de moi-même. Il y a toutes les moi qui ont marché dans ce froid festif : dure, solitaire, snob, orgueilleuse, narcissique, perdue sans jamais l’être, pleine d’espoir, persuadée comme aujourd’hui de me diriger dans la bonne direction, que ma vie était exactement comme il fallait qu’elle soit.
Est-ce que s’accompagner des vieux soi serait le secret pour ne pas se sentir seule ? J’en ai écrit, des lignes de code à cette époque, et noirci de grands cahiers avec des équations. J’avais toujours dans la poche quelques papiers de Jon Arons. J’avais toujours mon carnet Moleskine pour les notes de ce journal, et pas encore de smartphone. J’étais très amoureuse de P., et entre lui, l’écriture, et ma théorie des pulsars, cela constituait l’ensemble de mon monde. Je pensais, avant même Noël, que j’avais déjà tous mes cadeaux.
En quinze ans, les choses ont gagné en richesse et en complexité. Cet émerveillement à l’approche des fêtes, je ne l’ai pas perdu. Je crois que j’ai toujours tous mes cadeaux en avance, et le velours des rubans dans le creux de la gorge. Mon vœu, peut-être : superposer les énergies et les chances de tous ces fantômes du passé et du présent, les monter en interférences constructives, et rendre un peu de tout ce que j’ai reçu et reçois, à ceux qui m’accompagnent.
Son : Tom Walker, For Those Who Can’t Be Here, dans cette version délicate avec Kate Middleton au piano, à l’Abbaye de Westminster, Noël 2021. On la sent toute raide dans sa robe rouge, mais je salue le courage de se mettre ainsi à nu et en danger : d’être la Duchesse de Cambridge, la personne la plus scrutée du monde, d’avoir mon âge, d’être probablement dans sa crise de la quarantaine, d’être si digne, et d’accompagner Tom Walker par sens du challenge et du devoir, chapeau.