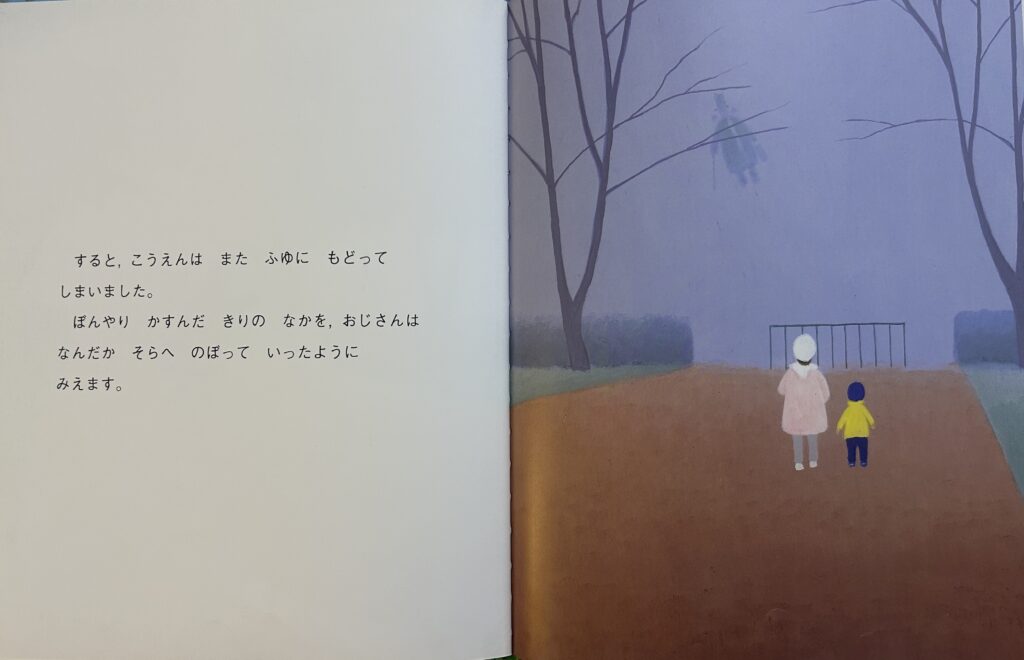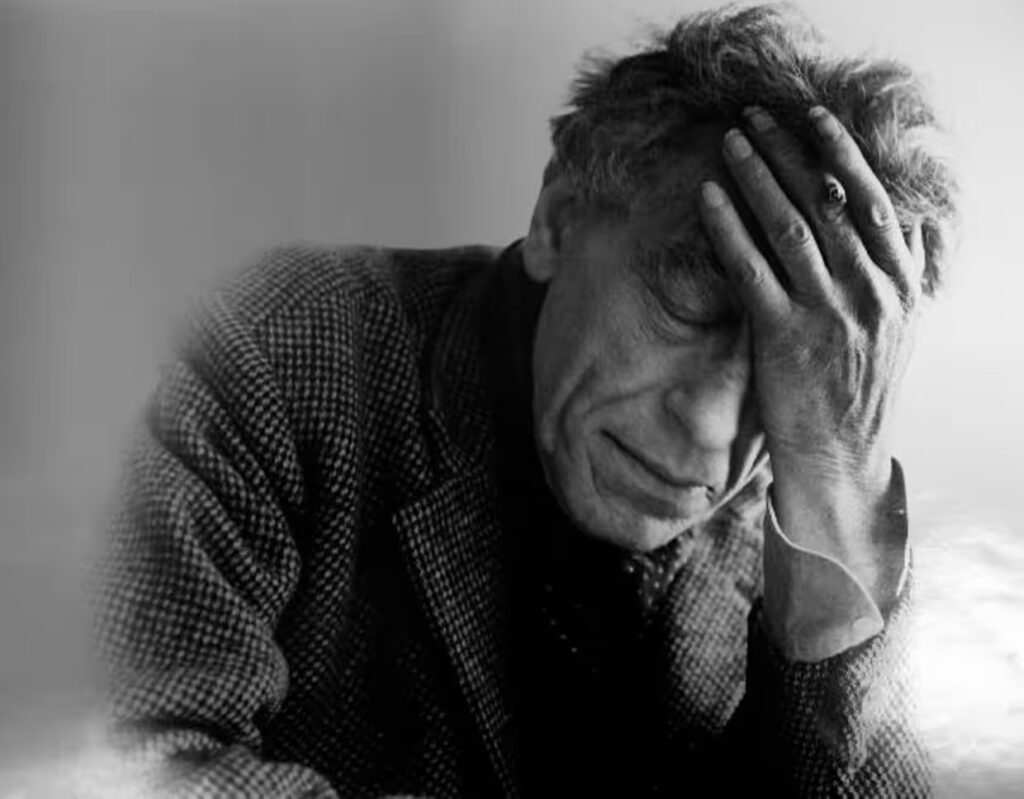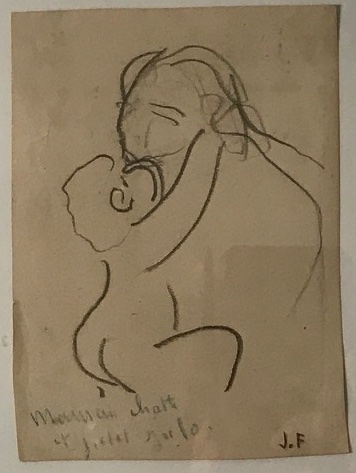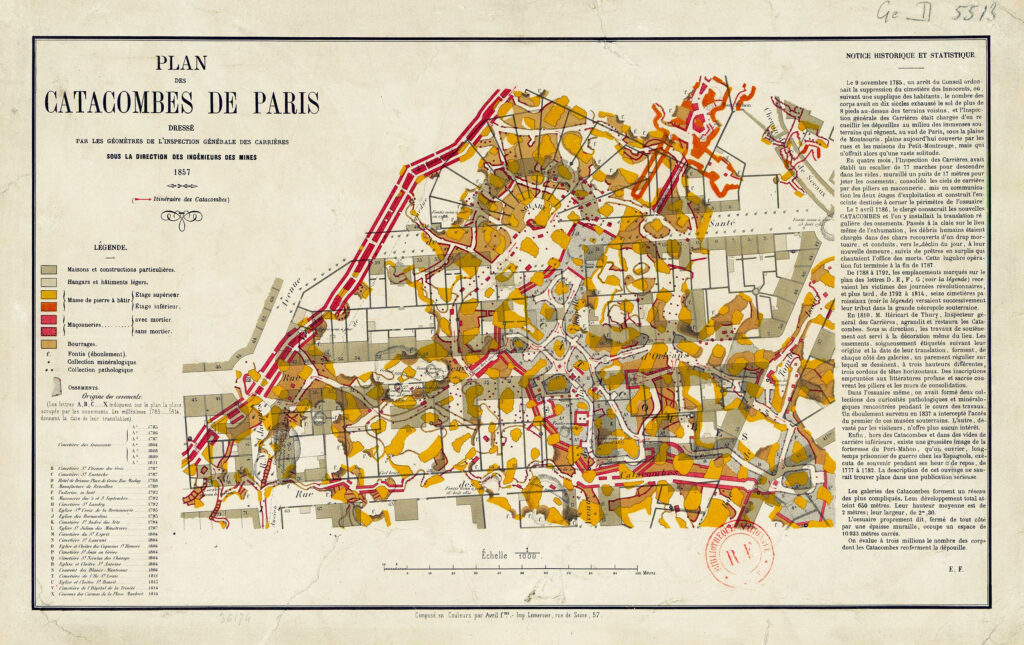Quand ça se met à exploser de partout, c’est presque un soulagement. D’un coup je suis percée par le pourtour de la recherche – alors que se déroule le fil rouge extraordinaire de l’aventure éditoriale et le fil marine extraordinaire de la science. Voici le quatrième volet de la série de Noël.
Son : Vladimir Martynov, Tatiana Grindenko, come in! IV. Movement, 2015
Mercredi, c’est N., étrange et naturel de la retrouver de ce côté-ci de l’Atlantique. Toujours entre les livres et les fauteuils de cuir rouge (j’ai mes fixettes), elle me confie qu’elle se tâte à prendre la tête d’une grande expérience. Ma réponse fuse :
« Évidemment il faut le faire. En plus, comme ça, tous les détecteurs de neutrinos de haute énergie seront dirigés par des femmes.
— Ah mais voilà une bonne raison. On se ferait des réunions au sommet, autour de wine & cheese.
— Où on se dirait tout ce qu’on pense de nos collègues mâles inefficaces, imbus, qui ne doutent pas d’eux-mêmes. »
Elle secoue la tête.
« Tu sais, voilà le hic. Je pense que je mériterais totalement qu’on me confie ce poste. Mais la collaboration ne me mérite pas. »
Elle rit, mais je suis sérieuse :
« Non, ils ne te méritent pas.
— Tout comme ils ne te méritent pas. »
Prétentieuses, arrogantes, bulldozers, et puis persuadées que nous sommes dix fois plus efficaces que la plupart de nos collègues mâles – mais surtout, je crois que nous sommes à ce moment-là toutes les deux désabusées et tristes.
Elle me demande :
« Don’t you ever feel overwhelmed? What do you do when you feel overwhelmed? »
Je réfléchis quelques secondes, je joue avec la cuillère sur mon café gourmand. Je réponds : « I write. »