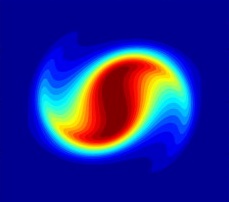J’envoie cette ligne à pas mal de monde, à qui voudra bien partager cette petite joie, au premier matin décalée où je sors dans les rues de ma ville de banlieue, dans la lumière fraîche estivale, je vais acheter des fromages et des pains au chocolat à la boulangerie… C’est bien, tout est là, immuable, les vieilles pierres, les rues étroites, et surtout dans notre maison, l’odeur des murs épais et du bois, des tomettes anciennes, une odeur de bonheur qui imprègne nos chambres, le goût de l’eau, les enfants sont fous de retrouver tous leurs jouets oubliés, nous nous attaquons aux cartons, au jardin envahi d’origan, de roses, de glycine, de lierre et d’abeilles, qui ressemble à celui secret de Hogson Burnett. Plus tard, quand je retrouve mon laboratoire et ses occupants, les bras et épaules tendrement serrés, les regards et les petites conversations entre les portes, les planches de charcuterie partagées à l’apéro, et la vie partagée, nous parlons gamins, flamme olympique, éclipse, formation stellaire dans les galaxies, H. et Y. s’empaillent sur des interprétations d’articles, et Pa. me conte les manigances avec l’Observatoire. C’est l’été, le doux moment du ralenti français, le temps de la respiration, de l’inspiration. J’ai l’impression de retrouver une place, ma place – oh je ne me fais pas d’illusion, ça durera un temps seulement – ça ne me ressemble tellement pas, et c’est très, très agréable.