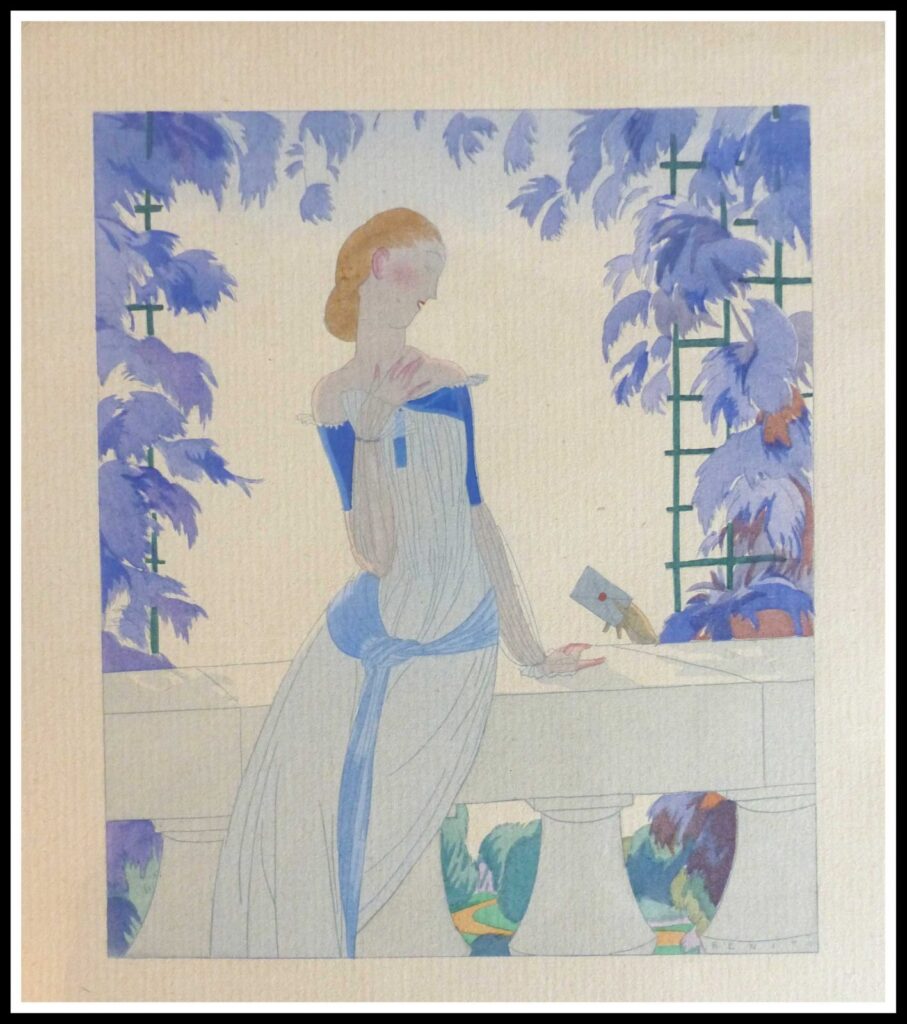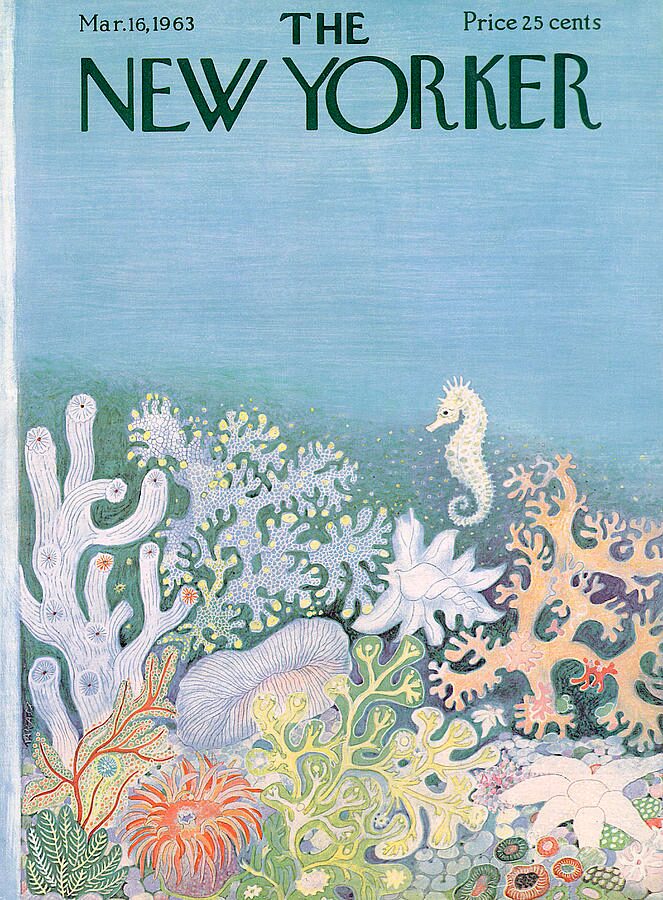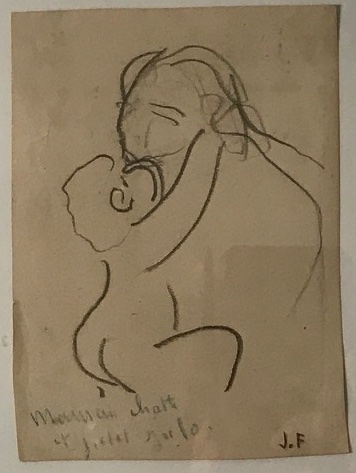Pour varier les expériences, samedi, c’est grosse fête d’anniversaire diapos-gâteau-rock band, dans une salle municipale ornées de boules discos, sous les tribunes d’un terrain de foot, déguisés en Seventies. On connaît mon amour pour la conversation superficielle non professionnelle. Après cette semaine, il ne me restait plus une once de savoir-vivre pour causer gamins, écoles, astrophysicienne, ou faire semblant d’être danseuse étoile à l’Opéra de Paris. Me suis donc bâfrée à l’excellent clafoutis aux tomates cerises, puis éclipsée dehors dans la lumière.
Et ?
Quelque chose est changé.
Sur les bancs du terrain de foot, je reçois la page d’un Pot Cassé, un prélude de Debussy. Pour l’édification des entraîneurs et maillots, je prononce à voix haute le spectre de Brocken, je souris sur la touche.
Quelque chose est changé.
Bergamote et gardénia, les senteurs tapissent les ficelles de phrases depuis les grands cahiers de mon adolescence jusque dans mon sac à main.
Quelque chose est changé.
Des fauteuils crapauds embusqués.
Enfin, pour manquer à tous mes devoirs de mondanité, je fais le mur au plus fort de la fête, pour aller vérifier chez moi, assise par terre sur les tomettes et le caramel de ma bibliothèque en palettes, avec ma robe bariolée 70’s et mes perles de bois dans les cheveux, si les Correspondances étaient aussi ronds qu’Harmonie du soir. [Ma réponse est non.]
Samedi, il est 15h, rien et tout est changé.
Échanger des photos de pages des Fleurs du Mal.
Et tant de gaines de mots jusqu’aux chœurs de la nuit, jeux réels ou fabulés, quelque chose est changé. Émouvant, serein, intemporel, minuit sonne, mais ce n’est jamais encore le moment des citrouilles.
Cela change et s’instaure, s’installe dans le temps.
Son : la plus belle interprétation de Clair de Lune de Claude Debussy, par les frères Sergio et Odair Assad et leurs deux guitares féeriques.